| Crédits audio et multimédia |
|---|
| Les ressources audiovisuelles ont été réalisées par François Salisson du service Aide numérique de l’Université Bourgogne Europe – Pôle des Systèmes d’Information et des Usages du Numérique de l’Université Bourgogne Europe. |
| Certains enregistrements en plus d’être audio sont filmés et ont parfois des pièces jointes (bibliographie, exemplier). |
| Vous pourrez accéder aux pièces jointes à cet enregistrement via le triangle blanc s’affichant en haut à droite du lecteur. Cliquez alors sur le petit icône en forme de trombone pour ouvrir le menu. |
| Ces documents sont protégés par licence Creative Commons : patenité – pas d’utilisation commerciale – pas de modification |
 |
| Les captations et le montage ont été réalisés par François Salisson. |
THÉORIES ET PRATIQUES LINGUISTIQUES
Mardi 08 octobre 2019, 15h 00 – 17h 00, Forum des savoirs MSH
Home thoughts from abroad: teaching English in France, pre- and post-Brexit?
Camela Chateau Smith, EA 4178, CPTC, UB
Mardi 15 octobre 2019
Le naturalisme linguistique dans l’histoire de la pensée et ses enjeux politico-culturels
Luca Nobile, EA 4178, CPTC, UB
Mardi 22 octobre 2019
Lorsqu’Henri Maldiney s’intéresse à la traduction
Bénédicte Coste, TIL, UB
Mardi 5 novembre 2019
La question de la réforme orthographique du français à travers les débats de la fin du 19ème siècle
Thomas Vincent, IUT Dijon – Département Information-Communication
Mardi 19 novembre 2019
Linguistique générale et linguistique universelle
Olivier Soutet, Sorbonne Université
Mardi 26 novembre 2019
Les soirs d’été et les soirées d’hiver
Kirill Ilinski, Sorbonne Université
Mardi 03 décembre 2019
La correspondance d’une femme de soldat en Bretagne romane (1915-1917)
André Thibault, Sorbonne Université
Mardi 17 décembre 2019
Je ne promets pas de ne pas assassiner le Président de la Présipauté de Groland
Samir Bajrić, EA 4178, CPTC, UB
Mardi 29 septembre 2020, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Langues, locuteurs et comportements linguistiques à travers une expérience au C.I.E.F.
Sebastiano Tomarchio, C.I.E.F. Dijon
Comment s’adresser à un public de langue et de culture diverses ? Une fois surmonté l’obstacle de la langue – en utilisant par exemple le français comme langue commune – comment être sûr que la communication soit correctement établie ? Dans ce processus, quel rôle jouent les références culturelles ? La langue n’est-elle pas après tout l’expression d’une « civilisation » et non pas le contraire ? A partir de ces questions je vais proposer quelques pistes de réflexion, en m’appuyant sur mon expérience en tant qu’enseignant et animateur culturel au sein du Centre International d’Etudes Françaises.
Mardi 6 octobre 2020, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Talking to foreigners: opening doors to the desire for words -and more
Michèle Bichot, université de Bourgogne
The objective of this series of presentations is to highlight different aspects of words and language which may not be sufficiently taken into account in the teaching of English as a foreign language in France. Some central attributes of words and language having been described, connections will be suggested between the very real but neglected characteristics of words and language on the one hand and teaching methods and activities on the other.
The presentation ’s apparently enigmatic title will be explained in Part 1. The question of resistance to learning a second language at school will be discussed and a question will be raised: can this learning be perceived as a form of treason by the learner? The notions of intimacy, norms, and play will be discussed. Then some connections will be made between the different aspects or degrees of resistance and teaching methods and activities.
Mardi 13 octobre 2020, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Les sens et les mots. Des rapports naturels entre sensorialité, langue et sémantique
Laurent Gautier, université de Bourgogne
Le développement des sémantiques cognitives conjugué aux avancées méthodologiques liées à la mise à disposition des linguistes de grandes masses de données (corpus) et / ou à la production de données expérimentales a remis au goût du jour les questions touchant à la façon dont le discours « met en mots » les perceptions sensorielles. De là à parler de l’avènement d’une « linguistique sensorielle », ou plutôt « du sensoriel », il n’y a qu’un pas déjà franchi par un certain nombre de chercheurs.
Il s’agira 1) de démontrer l’enjeu que représente la phase de constitution des données d’analyse, dans leurs dimensions d’authenticité, de représentativité et d’homogénéité que ce soit avec ou sans stimulus, 2) de discuter la dimension constructiviste du sens des descripteurs sensoriels nécessitant des modèles d’analyse holistiques reconnaissant au discours et aux interactions le rôle premier et 3) d’illustrer, par le recours à des études contrastives, la dimension culturelle de ces descripteurs.
Mardi 20 octobre 2020, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
L’argot ou l’école buissonnière de la langue
Hugues Galli, université de Bourgogne
Il y a trente piges. Il y a belle lulure donc… Une paille, les années quatre-vingt dix ! Du vingtième siècle ! « Une époque que les moins de vingt ans… » Bref, du temps que Zinedine Zidane avait encore du cresson sur le caillou. L’était tout mélanco, l’ancien pisse-copie du Nouvel Obs, qui se font tartir comme des rats morts sur les bancs des bahuts de France et de Navarre). Il avait le bourdon. « Le Blues de l’argot »* qu’il observait. Concurrencé par l’ « argot fast-food ». L’argot à toutes les sauces. Le franglais**, le français kiskoze*** et même bientôt (prémonition ?) le français des técis de Jean-Pierre Goudailler. Dis-moi Saïd, comment tu tchachtes ? Et toi, Vinz ? J’vais en faire un dico****. Et préfacé par Claude Hagège, siouplaît ! Imaginez : « Deux linguistes dans la ville »
Mais voilà qu’on digresse…
C’est peut-être aussi ça l’argot ? Une idée qui en appelle une autre. Puis une autre encore.
Elle est passée où la langue fleurie, la langue verte ? L’argot des « vrais de vrais » ?
On y regardera de plus près, promis. Nostalgiques s’abstenir.
Mardi 3 novembre 2020, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
La polysémie du pronom on à la lumière de la psychomécanique du langage
Manar El Kak, Sorbonne Université
L’objectif de cette communication consiste à démontrer comment la psychomécanique du langage permet de rendre compte de la polysémie d’un signe linguistique, renvoyant ainsi à la multiplicité de ses signifiés d’effets en discours à un signifié de puissance unique en langue, le pronom on en étant l’illustration. Car, en discours, ledit pronom possède un ensemble de valeurs contradictoires : celle de 1re personne du singulier, de personnes 4, de personne 5, ainsi que celle de 3e personne du pluriel, tout en imposant un accord syntaxique de 3e personne du singulier au verbe qui l’accompagne. Par conséquent, on constitue le cas typique d’un morphème qui possède n valeurs correspondant à n signifiés d’effets.
Une fois ces données révélées, une approche énonciative de la psychomécanique du langage sera amorcée, et ce, dans l’objectif d’expliquer la présence de la 1re personne à l’intérieur d’un pronom de 3e personne. Cela nous conduit à la fin à identifier le signifié de puissance de on en langue, et à le représenter par un tenseur binaire radical capable de générer toutes les valeurs discursives.
Mardi 10 novembre 2020, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Sociolinguistique, sémantique et esthétique : le cas du jazz
Jean Szlamowicz, université de Bourgogne
Nous avons tenté dans notre dernier ouvrage d’aborder une réalité socio-esthétique par le biais du langage. Là où de nombreuses études font l’histoire du jazz ou l’esthétique du jazz à l’aune de leurs préférences ou de biais téléologiques, nous sommes partis des spécificités sociolectales repérables dans les propos et productions des acteurs du jazz. Cela permet de dégager des thématiques et des pratiques qui éclairent la réalité esthétique, historique et sociale.
Ainsi conçue, l’étude du lexique jazzistique sur le plan sémantique, stylistique et sociolectal renvoie à l’univers de connotations et d’usages qui sont le fond culturel propre du jazz et révèle des strates de mémoire fondamentales. On espère ainsi contribuer à cerner ce que désigne le mot jazz lui-même, y compris en croisant sémasiologie et onomasiologie dans le cadre de l’analyse du discours — en particulier pour comprendre pourquoi on prétend si souvent que « le jazz est indéfinissable ».
Ouvrage : Jazz Talk. Approche lexicologique, culturelle et esthétique du jazz, PUM, 2020
Mardi 17 novembre 2020, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Langues en danger et revitalisation
Ksenija Ðorđević Léonard, université de Montpellier 3
La question des langues menacées ou en danger, en Europe et dans le monde, n’est pas seulement une « mode », mais un véritable problème de société, lié au développement de la mondialisation, à la globalisation des échanges, mais aussi aux relations de pouvoir inégal entre communautés d’intérêts.
Dans le cadre de ce séminaire, nous nous interrogerons sur les critères qui permettent de juger de la vulnérabilité des langues du monde, avant de présenter les principaux lieux où la diversité linguistique semble condamnée à plus ou moins long terme. Pour chaque grande zone géographique (Europe et Eurasie, Asie, Afrique, Australie et Pacifique, Amériques), nous choisirons quelques exemples qui montrent ce que les linguistes font et sont capables de faire sur le terrain, avec la participation de la communauté linguistique. Les exemples choisis, différents à tous points de vue, participent tous d’une même préoccupation : considérer le phénomène des langues en danger non pas comme une fatalité, mais comme la cristallisation de conflits socioculturels ou socio-économiques, parfois inévitables, souvent injustes.
Mardi 24 novembre 2020, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Transferts sémantiques : le cas des verbes dénominaux en français
Pauline Haas, université Paris 13
Cette étude propose d’explorer les liens sémantiques entre des bases nominales et leurs dérivés verbaux en français. L’étude se base sur 330 paires N-V dans lesquelles le nom est la base morphologique (Nb) et le verbe est le dérivé par affixation (Vdénom). Les affixes étudiés sont les préfixes a-, dé-, é- et en/em- et les suffixes -ifi(er) et -is(er) : CRÉDIT > ACCRÉDITER, COURAGE > DÉCOURAGER, CRÈME > ÉCRÉMER, BARQUE > EMBARQUER, EXEMPLE > EXEMPLIFIER, FAVEUR > FAVORISER.
Nous souhaitons explorer une hypothèse formulée pour l’anglais par Harley (2005), hypothèse selon laquelle les Vdénom construits sur des Nb comptables sont téliques et ceux construits sur des Nb massifs peuvent être atéliques ou téliques. Nous vérifierons empiriquement l’existence d’un héritage sémantique entre ces deux paires notionnelles lors du passage de la catégorie des noms à celle des verbes, et nous préciserons la fonction (prédicative ou référentielle) de la base nominale dans la construction du sens du verbe dérivé.
Mardi 1er décembre 2020, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Langues et linguistique : la vulgarisation via les nouveaux médias
Romain Filstroff / Monté de Linguisticae
La vulgarisation est une pratique visant à rendre le savoir accessible. Si simplifier peut paraitre simple, ce n’est paradoxalement pas le cas : c’est en réalité un exercice délicat, qui nous expose aussi bien aux critiques des experts que des profanes. Les premiers pointeront le manque de précision ou les libertés prises avec la réalité scientifique du discours tandis que les seconds pointeront le manque de clarté ou le niveau de connaissances préalable requis pour une bonne compréhension.
La vulgarisation à destination du grand public sur une plateforme comme YouTube expose aussi à des problématiques supplémentaires : il faut captiver l’audience, rendre un sujet vendeur, et dans le cas de la linguistique susciter un intérêt pour une discipline méconnue. La viabilité économique d’une chaine professionnelle dépend souvent de ce seul facteur. Parfois, c’est un autre public que l’on cherche à attirer : des annonceurs, des éditeurs ou des producteurs.
Mardi 8 décembre 2020, 15h 00 – 17h 00, Forum des savoirs MSH
« Querelle de l’analogie » : fausse querelle et vrais enjeux
Guillaume Bonnet, université de Bourgogne
En 45 av. J.-C., Varron entreprend enfin de satisfaire la promesse faite depuis quelques années à Cicéron de lui dédier un ouvrage nouveau, et se lance dans la rédaction d’un traité sur la langue latine (De lingua Latina libri). Des vingt-cinq livres de cet ouvrage aujourd’hui ruiné, il en reste trois d’étymologie et trois autres, qui les suivent immédiatement, (8-10) et constituent une approche théorique de la morphologie, interne comme externe. L’approche prend d’abord la forme d’une disputatio in utramque partem dans laquelle les adversaires puis les tenants du rôle structurant de l’analogie confrontent leurs arguments, avant que Varron ne conclue par l’exposé de sa propre conception de l’action analogique en latin, et de ses limites. L’arrière-plan des discours est nettement grec, comme on voit à certains détails, et Varron l’écrit parfois ; pour autant, est-on sûr qu’il a jamais existé dans le monde hellénistique une « Querelle de l’analogie », comme on a appelé cette controverse qui, finalement, n’est documentée un peu précisément que par Varron ? Tenter une réponse, c’est dévoiler des enjeux qui restent actuels pour tous les linguistes.
Mardi 15 décembre 2020, 15h 00 – 17h 00, Forum des savoirs MSH
Laissez-moi te tutoyer pendant qu’on se vouvoie !
Samir Bajrić, université de Bourgogne
Les termes d’adresse, nombreux et complexes à travers les langues du monde, créent une source inépuisable de curiosité conceptuelle dès lors que les besoins énonciatifs des locuteurs oscillent entre tutoiement et vouvoiement. Bien qu’elle soit à l’écart des universaux du langage, cette différentiation hante de manière saillante les langues que nous examinons dans cette contribution. Chacune d’entre elles présente des paramètres communs à d’autres langues et ajoute des particularités qui lui sont propres. Les alternances des pronoms d’adresses (fr. tu, toi, vous ; esp. tú, vosotros, Usted, Ustedes ; it. tu, voi, Lei ; all. du, Sie, ihr, Ihr ; sl. ti, vi, Vi) demeurent assujetties non seulement aux contraintes sociales régissant les relations humaines, mais également et de surcroît aux différents états intentionnels qui « sévissent » lors des interactions verbales (B. Coffen, 2002 ; V. Ćosić, 2017 ; C. Kerbrat-Orecchioni, 1990 ; S. Schwenter, 1993 ; P. Molinelli, 2002, etc.). Et que dire de l’allemand qui permet de tutoyer au pluriel ? Cette multitude d’éléments affecte non seulement la linguistique comparée, mais aussi et de surcroît la dimension phénoménologique des relations interpersonnelles.
Résumés
Pauline Haas
Université Paris 13
Classification sémantique des noms en français
De nombreuses études recourent à la classification sémantique, que ce soit de manière centrale, dans le but de décrire et de conceptualiser le sens des mots (études sémantiques et lexicologique), ou comme matériaux pour traiter d’autres questions linguistiques (par exemple, la mise en évidence les liens entre opérations morphologiques et construction du sens, l’exploration des contraintes sémantiques de sous-catégorisation pesant sur les arguments des prédicats, ou encore pour les besoins de désambiguïsation sémantique rencontrés en traitement automatique des langues).
Le travail présenté, élaboré en collaboration avec Lucie Barque (univ. Paris 13, sémanticienne), Richard Huyghe (univ. de Fribourg, Suisse, sémanticien) et Delphine Tribout (univ. de Lille, morphologue), propose une classification sémantique des noms du français établie au moyen de tests linguistiques distributionnels. Il s’agit d’aboutir à une typologie sémantique des noms fondée sur leurs propriétés linguistiques. Il s’agit également de proposer concrètement une méthode de classification.
Après avoir brièvement présenté les différents types de classements sémantiques existants, je présenterai en détail la typologie sémantique proposée qui se compose de 14 classes simples et de 7 classes sémantiquement complexes (ou hybrides). Seront abordées les difficultés liées à la description de la polysémie et à sa distinction avec la complexité sémantique, ainsi que les questions liées à la classification en langue vs l’annotation en corpus.
Guillaume Coqui
Université de Bourgogne
À la faveur de ce que d’aucuns ont nommé son « tournant linguistique », la philosophie du XXe siècle s’est redécouvert un intérêt pour la question de la signification, ou de la signifiance, des énoncés, promue au rang d’une question logiquement antérieure à celle de la vérité des thèses. Ce faisant, elle s’est obligée à fournir une analyse du langage qui est venue nourrir et, parfois, concurrencer l’analyse des linguistes, et dont un aspect nous retiendra ici : à quel type de conditions ou de critères peut-on recourir pour décider de la signifiance d’un énoncé ou d’un terme ? Autrement dit, comment identifier le non-sens, et, partant, le sens ? Peut-on soutenir que c’est la signification individuelle des termes qui composent un énoncé qui détermine si l’énoncé complet a un sens, ou faut-il plutôt recourir à une théorie alternative du non-sens, qui est celle de Frege, ainsi que l’ont soutenu à la fin du siècle dernier Cora Diamond (The Realistic Spirit, 1991) et, à sa suite, Jacques Bouveresse (Dire et ne rien dire, 1997) ? L’examen de ces questions permet de montrer à quel type de décisions théoriques la question du non-sens nous contraint, en ce qui concerne la nature de la signification, de la compréhension et de l’interprétation.
Dubravka Saulan
Université de Bourgogne
Trop drôle : sujet riant, identitèmes et positionnement dans le discours
Dans cette communication, nous tâcherons d’analyser la notion d’identitème à l’aide du sujet pensant-parlant (riant ?) dans son versant interprétatif. Positionné dans le discours, il y tisse sa toile identitaire grâce à et malgré son hétérogénéité. Cette dernière se manifeste avant tout dans le discours (public), dès lors que le locuteur en question assume son rôle de récepteur des messages concernés. C’est par le biais d’interprétation qu’il puise dans sa mémoire linguistique et socio-culturelle et qu’il s’attaque au jeu d’identitèmes. Force est de constater que ce jeu devient à son tour hétérogène. Produits par l’émetteur – qui peut ne se manifester que marginalement dans le discours -, les identitèmes passent par le sujet-parlant, avant de reproduire leur « je » et leur « jeu » dans l’identification du sujet interprétant (locuteur hétérogène). Nous essayerons de réfléchir comment la même identification pourrait être altérée chez le locuteur bi- ou multilingue, notamment dans l’exemple des figements et des semi-figements portant sur l’humour. Afin d’y parvenir, il nous sera incontournable de re-questionner la notion de sémiosphère (identième vs. culturème : sémiotique culturelle oblige), en la posant en tête de tous les éléments qui parlent d’identitèmes sans les nommer. Nous étudierons certains d’entre eux (préconstruit, sujet pensant, sujet parlant, déictique, etc.). L’utilité de l’analyse du discours public dans cette optique repose sur le fait qu’il partage un certain nombre de traits distinctifs avec l’identitème lui-même : il repose sur la mémoire collective, il est (plutôt) créatif, référentiel et compressé ; enfin, il est la preuve physique de l’importance de l’intertextualité.
Hugues Galli
Université de Bourgogne
La langue verte permet-elle de rêver en couleur ?
Il y a trente piges. Il y a belle lulure donc… Une paille, les années quatre-vingt dix ! Du vingtième siècle ! « Une époque que les moins de vingt ans… » Bref, du temps que Zinedine Zidane avait encore du cresson sur le caillou (c’est dire si c’est daté, les poteaux !) Pierre Merle se lamentait déjà. L’était tout mélanco, l’ancien pisse-copie du Nouvel Obs (pas le prof de socio, qu’a le même blaze, mais qui s’intéresse de près aux p’tis merdeux (truisme !) qui se font tartir comme des rats morts sur les bancs des bahuts de France et de Navarre). Il avait le bourdon. « Le Blues de l’argot »* qu’il observait. Concurrencé par l’ « argot fast-food ». L’argot à toutes les sauces. Le franglais**, le français kiskoze*** et même bientôt (prémonition ?) le français des técis de Jean-Pierre Goudailler. Dis-moi Saïd, comment tu tchachtes ? Et toi, Vinz ? J’vais en faire un dico****. Et préfacé par Claude Hagège, siouplaît ! Imaginez : « Deux linguistes dans la ville ». Scénario et réalisation : José Giovanni. Pas tout frais, le José, mais toujours bon pied bon œil ! Ça s’passe entre deux barres HLM. Cité La Noé, un jour où le ciel est gris (y’en a-t-il d’autres ?) Chanteloup-les-Vignes, dans le 7-8. Comme dans La Haine. Le couple Goudailler/Hagège crève l’écran. Gabin et Delon n’ont qu’à s’rabiller. Au vestiaire les vieux kroumirs !
Mais voilà qu’on digresse…
C’est peut-être aussi ça l’argot ? Une idée qui en appelle une autre. Puis une autre encore. Des images plein la tête. Des associations. Et toujours par métaphore. Du sous-Proust. En moins barbant quand même ! L’école buissonnière de la langue.
Elle est passée où la langue fleurie, la langue verte ? Existe-t-il toujours, le « parler canaille » ? L’argot des « vrais de vrais » ? Et qu’est-ce qu’ils sont devenus les princes de l’argot***** ? De l’argot d’antan ?
On y regardera de plus près, promis. Nostalgiques s’abstenir.
*Merle, Pierre, Le blues de l’argot, Paris : Seuil, 1990.
** Étiemble, René, Parlez-vous franglais ? Paris : Gallimard, 1964.
***Beauvais, Robert, Le français kiskoze, Paris : Fayard, 1975.
**** Goudailler, Jean-Pierre, Comme tu tchachtes ! Dictionnaire du français contemporain des cités, Paris : Maisonneuve et Larose, 1997.
***** Cérésa, François, Les princes de l’argot, Paris : Éditions Écriture, 2014.
Manar El Kak
Sorbonne Université
La théorie des aires chez Gustave Guillaume et son application à la langue arabe
Dans ses Leçons de linguistique, Guillaume s’est intéressé à la typologie des langues en décrivant, notamment pour le français, les mécanismes à l’œuvre dans la formation du mot. Sa typologie, novatrice du fait qu’elle aborde en diachronie et en synchronie la formation du mot et son passage vers la phrase et inversement, aboutit à une classification des langues selon trois aires, prime, seconde et tierce, dont les plus représentatives sont : le chinois, langue à caractères, l’arabe, langue à racines et le français, langue à radical. Diachroniquement, les langues indo-européennes, langues à mots se situent en exophrastie, c’est-à-dire, au seul niveau de la langue amenant à un achèvement matériel et formel du mot. Quant aux langues sémitiques, dont l’arabe fait partie, elles sont à la fois exophrastiques et endophrastiques, dans la mesure où la formation du mot passe par deux saisies lexicales, la première se situe en langue et la seconde en discours.
Par cette théorie de trois aires, il semble que le mot arabe connait deux étapes dans sa formation selon Guillaume. Or, selon certains linguistes arabes et arabisants, le mot arabe est constitué de deux parties : une racine et un schème, responsables respectivement du contenu sémantique et grammatical, mais où chacune d’elles est considérée comme un signe linguistique (Fleisch, 1961 ; Larcher, 1995). Ainsi, notre première question s’oriente vers l’applicabilité de cette théorie à la langue arabe. Ce qui nous amène à nous interroger sur le mot arabe en tant qu’entité à double signe : comment se forme-t-il ? Se forme-t-il en langue ou en discours ? Qu’en est-il des cas où une racine donne naissance à des mots polysémiques ? Ces questions et tant d’autres vont nous permettre d’aborder la formation du mot en arabe, afin de vérifier l’applicabilité de la théorie des aires à ladite langue, en prenant en considération au moins deux paramètres : le morphème lexical, ou racine, et le morphème grammatical, ou schème.
Ľudmila Lacková
Université Palacký, Olomouc, République Tchèque
Peirce et le structuralisme
C’est une tendance générale de la sémiotique de considérer Peirce en contradiction avec le mouvement structuraliste, également appelé sémiologie. Cette contradiction n’est qu’une décision arbitraire des sémiologues actuels. Peirce a développé sa théorie indépendamment du mouvement structuraliste (il ne pouvait en être autrement en raison de la nature linéaire du temps) et les sémiologues aussi : au moins au début du mouvement, si l’on part de Saussure, il est clair que les deux théories ont émergé indépendamment l’une de l’autre. S’il y a eu des convergences dans les générations ultérieures de la sémiologie, comme dans le cas de Roman Jakobson, elles ne font certainement que soutenir l’hypothèse selon laquelle il n’y a rien de contradictoire entre la sémiotique de Peirce et le structuralisme européen. L’argument selon lequel l’approche dyadique présumée « fermée » n’est pas commensurable avec l’approche triadique permettant une sémiose illimitée ne tient pas si l’on considère que les sémiologues avaient d’autres stratégies pour décrire le processus interprétatif illimité, comme les chaînes connotatives par exemple. Démontrer la conciliabilité du structuralisme avec la sémiotique interprétative de Peirce était l’objectif général de l’œuvre d’Umberto Eco. Je voudrais aller encore plus loin et faire apparaître que Peirce était dans une certaine mesure plus « structuraliste » que les sémiologues eux-mêmes. Pour cela, je m’appuierai sur des exemples d’aspects formels tirés des manuscrits de Peirce et considèrerai ce dernier comme un prédécesseur de la syntaxe valentielle de L. Tesnière.
Jean-Hadas-Lebel
Université Lumière-Lyon 2
Que savons-nous de la flexion nominale en étrusque ?
Alors qu’au milieu du Ier millénaire av. J.-C. les Étrusques dominaient une bonne partie de l’Italie, l’irrésistible ascension d’une petite cité du Latium, Rome, a fini par faire disparaître de la carte ce peuple si singulier. Un des principaux mystères entourant les Étrusques vient de leur langue, encore aujourd’hui très obscure. Bien qu’ils nous aient laissé plus de dix mille inscriptions, notre compréhension de leur langue progresse très difficilement. Il faut dire que l’étrusque n’appartient à aucune famille linguistique connue. Qui plus est, les linguistes ne disposent d’aucune Pierre de Rosette susceptible de faciliter leur tâche. Toutefois, grâce à l’acharnement d’une poignée d’étruscologues, notre compréhension de la flexion nominale étrusque a connu une avancée non négligeable ces dernières années. Comme on le verra, c’est à la typologie que l’on doit ces récents progrès. L’auteur de ces lignes est d’ailleurs persuadé que la typologie a encore beaucoup à nous apporter pour la connaissance de l’étrusque en général.
Romain FILSTROFF
Vidéaste
La vulgarisation est une pratique visant à rendre le savoir accessible. Si simplifier peut paraitre simple, ce n’est paradoxalement pas le cas : c’est en réalité un exercice délicat, qui nous expose aussi bien aux critiques des experts que des profanes. Les premiers pointeront le manque de précision ou les libertés prises avec la réalité scientifique du discours tandis que les seconds pointeront le manque de clarté ou le niveau de connaissances préalable requis pour une bonne compréhension.
La vulgarisation à destination du grand public sur une plateforme comme YouTube expose aussi à des problématiques supplémentaires : il faut captiver l’audience, rendre un sujet vendeur, et dans le cas de la linguistique susciter un intérêt pour une discipline méconnue. La viabilité économique d’une chaine professionnelle dépend souvent de ce seul facteur. Parfois, c’est un autre public que l’on cherche à attirer : des annonceurs, des éditeurs ou des producteurs.
Il n’existe ni modèle, ni bonne pratique. Il s’agit là d’une pratique émergente au sein d’un milieu très changeant. Les vulgarisateurs sont souvent des acteurs atypiques, parfois issus d’autres spécialités que celles qu’ils partagent, donnant lieu à des positionnements différents et des légitimités variables.
C’est alors au travers d’un parcours personnel incarné que seront abordées ces questions et le thème de cette intervention.
Inès SFAR
Sorbonne Université
Le discours lexicographique entre précision définitoire et ambiguïté d’exemplification
Le discours lexicographique permet, selon A. Rey (1995 : 95) de fournir « une image des usages de la langue » à partir d’un discours de base qui peut être réalisé ou virtuel. C’est parce qu’il est virtuel qu’il favorise une stratégie discursive propre, permettant de produire un discours exemplifiant, « sémiotiquement complexe, hétérogène, démonstratif, idéologique-culturel, didactique et passablement pervers » (1995 : 95). Les exemples utilisés dans le discours lexicographique sont présentés comme des « faits de discours individuels assumés ou non » et qui « renvoient donc inductivement à une catégorie de faits (syntactiques, sémantiques, pragmatiques) pour dégager une norme, soit objective (statistique, philologique), soit projective (sociale, politique, idéologique) » (1995 : 101). Au-delà de son triple statut, fonctionnel, sémantique, social et pragmatique, l’exemple a deux sémantismes : « l’un indirect, renvoyant à un signe du langage, l’autre direct, renvoyant à un contenu conceptuel ou à un référent » (1995 : 103). Il fait l’objet d’une « double lecture ». C’est cette ambiguïté entre « mention » et « usage » que nous tenterons d’analyser dans la présente contribution. Nous partirons des exemples du Dictionnaire des expressions et locutions d’Alain Rey et Sophie Chantreau (1989, réed 2003) afin d’expliciter le lien qui existe entre le contenu définitoire de la locution et l’exemple, qu’il soit référencé ou pas. Le choix de notre corpus est motivé par le fait que ce type de dictionnaires présente plusieurs particularités, qui sont à rattacher, non seulement, à la nature de l’ouvrage, mais également à la forme des entrées lexicales choisies : les locutions et expressions, de par leur polylexicalité, présentent des variations qui rendent difficile leur classement alphabétique dans un dictionnaire et imposent au linguiste-lexicographe d’opérer des choix dans la sélection, qui ne sont pas toujours justifiables, notamment en ce qui concerne la relation qui existe entre l’entrée et les exemples (forgés ou citations) qui permettent de l’illustrer. Trois cas de figure se présentent à nous :
- Explicitation de la définition (sémantique et / ou pragmatique)
- Explicitation de l’exemple (anonyme ou référencé)
- Absence d’explicitation (définitoire et / ou exemplifiante).
Mots-clés : discours lexicographique, exemple, ambiguïté, discours oblique, définition, implicite.
Bibliographie
BALIBAR-MRABTI Antoinette. « Exemples lexicographiques et métaphores ». In: Langue française, n°134. Nouvelles approches de la métaphore. pp. 90-108. 2002.
FUCHS Catherine. Les ambiguïtés du français. Ophrys. 1996.
LEHMANN Alise (dir.). Langue française, n°106, L’exemple dans le dictionnaire de langue Histoire, typologie, problématique. Larousse. Paris. 1995.
L’HERMITTE René. « Lexicographie et idéologie ». In: Revue des études slaves, tome 54, fascicule 3, pp. 403-408. 1982.
MARTIN Robert. Inférence, antonymie et paraphrase. Klincksieck. 1976.
REY Alain. « Du discours au discours par l’usage : pour une problématique de l’exemple ». Langue française, n°106. pp. 95-120. Larousse. Paris. 1995.
REY Alain. CHANTREAU Sophie. Dictionnaire des expressions et locutions (1989, réed 2003). Le Robert.
Ksenija ÐORÐEVIĆ LEONARD
EA-739 Dipralang, Université Paul-Valéry Montpellier 3
La patrimonialisation des éléments identitaires : trois études de cas (Italie, Estonie, Serbie)
Dans cette communication nous allons observer comment s’opère la patrimonialisation de divers éléments identitaires (langue, culture, religion) de trois populations minoritaires en Europe, à partir de nos enquêtes de terrain réalisées en Italie, en Estonie et en Serbie, dans un passé récent.
La première de nos études de cas portera sur la situation de la minorité croate, installée au sud de l’Italie, dans le Molise, depuis le XVème siècle, qui conserve encore aujourd’hui l’usage d’une variante ancienne de sa langue – ce qui, en soi, en augmente la valeur patrimoniale. Le répertoire linguistique des Croates molisains est ainsi marqué par le feuilletage de plusieurs variétés : l’italien standard, le dialecte molisain italo-roman, le croate molisain ou le na-našu comme l’appellent les locuteurs, et – quoique plus rarement – le croate standard. Notre regard portera ici essentiellement sur le na-našu – la variété dialectale locale. Nous montrerons comment cette variété est réinvestie dans le cadre de la valorisation d’un héritage culturel original qui, sans passer par une revitalisation fonctionnelle, ne participe pas moins du développement social et culturel de toute une communauté.
La deuxième de nos études de cas portera sur la situation de la minorité slovaque de Serbie. Même si celle-ci représente seulement 0,73% de la population totale, et si sa langue, dans une situation de diglossie avec la langue majoritaire – le serbe, est minorisée dans l’espace public, la valeur ajoutée aussi bien commerciale que symbolique qui joue en faveur de la visibilité de la communauté slovaque se trouve – une fois n’est pas coutume – pas seulement dans la langue minoritaire, mais dans le domaine de l’art. Nous analyserons les stratégies de marketing touristique des communes dans lesquelles sont installées les Slovaques. Ces stratégies sont organisées autour de la valorisation du patrimoine culturel communautaire, à travers les nombreux musées d’art ou de traditions populaires, les ateliers de peintres ou de fabrication de violons, ou encore les maisons natales d’artistes, transformées en curiosités touristiques, qui parsèment le centre de la commune, et constituent à la fois le moteur et l’âme de ces localités.
Enfin, la troisième de nos études de cas portera sur les vieux-croyants d’Estonie. Cette population se définit aujourd’hui essentiellement par son héritage culturel et linguistique et par sa religion. Cependant, nous sommes ici dans une situation paradoxale, où la communauté (certes parfaitement russophone) s’identifie aussi à travers une langue – le slavon d’église – dont la maîtrise réelle est réservée à un cercle d’initiés, à travers une religion – la « vieille-foi » – dont la pratique ne résiste pas au recul du fait religieux dans l’espace européen, ainsi qu’un héritage culturel qui se fond en partie dans celui de leurs compatriotes russophones. Néanmoins, le sentiment de défendre une spécificité et une originalité est bien présent au sein de la communauté.
A partir de nos observations directes et participantes et de nos enquêtes de terrain réalisés dans les trois pays, nous verrons comment s’opère la patrimonialisation des éléments identitaires des populations minoritaires à cette époque où aussi bien la langue que la culture ou encore la religion sont réinvesties dans le cadre de la valorisation d’un héritage culturel original. Nous monterons que, sans viser une revitalisation fonctionnelle, la patrimonialisation ne rime pas ici pour autant avec la folklorisation ou la muséification. Elle témoigne d’un processus dynamique qui contribue au développement social et culturel d’une communauté, mais aussi de toute une région.
Samir Bajrić
Université de Bourgogne
Absence / omission de pronom personnel dans la phrase verbale
Encore une conférence sur les pronoms ?! (Sic !) Une quatrième (ou une troisième, je ne sais plus…) pour les six dernières années ? Oui, mes chers. Au risque de surprendre, de décevoir, de dérouter, bref, de dégoûter certains, j’ai décidé de poursuivre dans ladite voie, car le domaine est prometteur, le terrain est fécond, le phénomène est source permanente de curiosités. Et en parlant de ce dernier, c’est bien d’une certaine phénoménologie, d’une phénoménologie certaine que relève l’objet de la présente étude : s’intéresser à ces faits de langue-là où, pour faire simple en faisant diversion, la phrase verbale devient « décapitée », « guillotinée », privée de l’apparent essentiel. C’est ce que je nomme et renomme : langue sans tête ou absence / omission de pronom personnel (indice personnel de Tesnière) dans la phrase verbale. De nombreuses langues du monde affichent une syntaxe se prêtant à ce type d’emploi grammatical, voire de conception de l’énonciation :
- langues slaves (toutes) : russe : Не могу. ; bulgare : Мисля, че съм така; slave méridional : Mislim, dakle jesam; tchèque : Myslím, že ano ;
- latin : Cogito ergo sum.
- italien : Dove e come ci colpiranno, onestamente non lo so.
- espagnol : Estoy sediento. ; ¡Si, lo practicamos!
- roumain : Cred că așa sunt.
- albanais : Mendoj se jam ashtu.
- allemand : Muß sich daran gewöhnen.
Le français semble se situer à l’écart de cette particularité, si, bien entendu, nous limitons notre observation à sa norme grammaticale. La construction * Pense, donc suis est aussitôt jugée non conforme aux lois syntaxiques, puisqu’elle doit céder à Je pense, donc je suis. Néanmoins, certaines conditions discursives permettent de nuancer cette rigidité : ellipse inter-phrastique (A voté !) ; excursion diastratique (Fais chier !) ; etc. (Leeman 2006).
Bajrić S., 1996 : « Les pronoms : mots pleins semi-prédicatifs », dans École doctorale de Dijon, Université de Bourgogne, Questions de syntaxe, p. 1-33
Bajrić S., 2021 : « L’alternance des termes d’adresse entre tutoiement et vouvoiement : français, espagnol, italien », en collaboration avec Daniela Ventura, actes du colloque « Romanistika 100 ; 100 ans d’études romanes à Zagreb : tradition, contacts, perspectives », 15-17 novembre 2019, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Zagreb, p. 65-70
Leeman D, 2006, « L’absence du sujet en français contemporain : Premiers éléments d’une recherche », dans Information grammaticale, numéro 110, juin, p. 23-30
Tesnière L., 1927b, « Pronoms et indices personnels », dans Bulletin de la Faculté des Lettres de l’université de Strasbourg, pp. 61-65
Teyssier J., 1981, « Le système du pronom personnel allemand et ses implications morphosyntaxiques », dans Équipe de recherche en psychomécanique du langage, Langage et psychomécanique du langage, sous la direction de A. Joly et W.H.Hirtle, Québec, PUL, p. 151-185

Mardi 20 septembre 2022, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Séance inaugurale du séminaire (pas de conférence)
Samir Bajrić, université de Bourgogne
Mardi 27 septembre 2022, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Le micro-système temporel en français oral contemporain
Thierry Ponchon, université de Reims Champagne-Ardenne
Résumé
De prime abord, la syntaxe du français parlé se différencie de celle du français écrit par la brièveté des phrases et la simplicité de leur structure. La situation de l’énonciation immédiate, de dialogue notamment, par rapport à l’énonciation médiate dans la linéarité de l’expression écrite, entraîne des ruptures, des reprises, des amendements, des répétitions, des suspensions et s’accompagne souvent de gestes. Le discours parlé se présente donc comme une association de phrases correctes selon la norme grammaticale absolue et de bouts de phrases, de faux départs, de syntagmes et de mots fragmentaires ou isolés, comme dans cet exemple du corpus Elicop :
« eh bien c’est après que je suis venu ici à Gerzat après cette guerre n’est-ce pas je suis venu pour moi aussi personnellement euh j’ai passé les mei la meilleure partie de ma jeunesse euh à la guerre n’est-ce pas. » (http://bach>. arts.kuleuven.ac.be/lancom/abstract.htm)
Cet extrait montre que le tissu textuel est approximatif et contraire à ce qui est attendu de la forme écrite. Dans la mesure où ces caractéristiques du français parlé apparaissent dans nombre de couches sociales, elles peuvent être considérées comme spécifiques de ce registre. Et tout échantillon suffisamment étendu montre clairement l’importance cruciale des marques de structuration.
Plusieurs phénomènes syntaxiques typiques du français parlé sont ainsi aisément décelables : les répétitions, les ruptures de phrases, les suppressions, les faux départs, l’emploi des différentes formes présentatives, l’usage de la thématisation, les spécificités de l’interrogation intonative et la prédominance de la parataxe.
Ce sont ces différentes spécificités qui seront envisagées dans cette communication.
Mardi 4 octobre 2022, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
La linguistique théorique au regard de la linguistique appliquée
Pierre-André Buvet, université Sorbonne Paris Nord
Résumé
Notre exposé portera sur les interactions entre linguistique théorique et linguistique appliquée. Nous défendrons la thèse selon laquelle la linguistique appliquée sert de cadre expérimental à la linguistique théorique. Nous présenterons un modèle linguistique et des applications directement issues de cette modélisation. Nous discuterons ensuite des conséquences théoriques de la mise en œuvre de ces applications.
Mardi 11 octobre 2022, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Isabelle Monin, université de Reims Champagne-Ardenne
« LE CONSEIL DE CLASSE LE/LA FÉLICITE »
L’UBIQUITÉ ÉNONCIATIVE DE LA TROISIÈME PERSONNE DANS LES BULLETINS SCOLAIRES
Résumé :
Que ce soit pour distribuer accessits ou mises en garde, éloges, remontrances ou conseils, les enseignants usent avec une relative solennité de la troisième personne dans les bulletins scolaires. Particulièrement dotée de souplesse morphologique et référentielle, elle est susceptible de renvoyer à toutes les places d’interlocution, un phénomène lié notamment aux spécificités énonciatives de ce genre de discours.
Sujet énonciatif, sujet syntaxique et/ou sujet délocuté, nous en observerons les manifestations visibles et invisibles dans une sélection d’occurrences issues d’extraits de Livrets scolaires uniques (LSU), du Cycle 1 au Lycée. En effet, cette troisième personne est capable d’y revêtir différentes formes : prénom, pronoms (personnel et relatif), groupe nominal (allusif, individuel ou collectif), description définie autonyme et même ellipse, elle est utilisée par les énonciateurs enseignants pour désigner n’importe quel référent concerné de près ou de loin par l’énoncé.
En conséquence, nous questionnerons la valeur communicationnelle de ces choix lexicaux et syntaxiques, à partir de la relation entre les places d’interlocution et les positions énonciatives (Saunier 1998) dans ce contexte, et son incidence sur la portée pragmatique de nos énoncés. Plus précisément, au vu du schéma énonciatif du bulletin scolaire et de son rôle, si le concept exclusif de non-personne (Benveniste 1966/1974) semble ici un leurre – en ce que l’utilisation de la troisième personne ne peut exclure son référent des destinataires directs de ces écrits – elle met à mal les possibilités d’intersubjectivité, d’une part, et d’autre part fonctionne comme un “masque discursif” (Riedinger 2021) lorsque l’énonciateur en use pour se désigner lui-même.
Mardi 18 octobre 2022, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Damien Deias, université de Lorraine
Résumé :
Le 5 janvier dernier, tous les grands titres de la presse nationale française relayaient un segment de discours extrait d’un entretien qu’Emmanuel Macron avait donné la veille au Parisien : « Eh bien, là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire, jusqu’au bout. ». L’énoncé était alors qualifié de « petite phrase », dénomination discursive forgée par les professionnels de la communication et les journalistes, et aujourd’hui connue et reconnue par le plus grand nombre. La circulation de cet énoncé est emblématique de ce que Maingueneau nomme la « panaphorisation », la saturation provisoire de l’espace médiatique par un événement de discours, qui s’accompagne d’une polémique sur la justification et le bien-fondé de sa production.
Ce phénomène médiatico-discursif est pourtant complexe. Fruit d’une co-construction verticale entre des acteurs politiques et des journalistes, le détachement de ces énoncés s’opère selon des critères qui constituent un contrat de communication implicite. Leur mise en circulation implique des réarrangements selon les genres de discours où ils sont insérés – troncations, reformulations partielles… – de sorte qu’une « petite phrase » correspond bien souvent à un ensemble de formulations, à l’instar des formules (Krieg-Planque). Enfin, objet de contre-discours et de parodies, la dénomination « petite phrase », catégorie dépréciée, caractérise souvent le discours de l’autre, celui de l’adversaire.
Au terme de cette réflexion, nous nous essayerons donc à répondre à la question posée par le titre : fallait-il vraiment prononcer cet énoncé et le verbe « emmerder », qui a résonné aux oreilles de nombreux destinataires comme un performatif ?
Mardi 25 octobre 2022, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Mary Bouley, université de Bourgogne
Résumé :
The vision of a lingua franca: the yearning goes back at least as far as Condorcet’s eighteenth-century dream of a universal language. Few would deny that in today’s internet- and social media-saturated world, that language is English.
Yet English is most certainly not that universal language permitting “equal knowledge of necessary truths” envisioned by Condorcet. It is a language colored by the colonial past of the British Empire and the present-day economic, military and cultural power (some would use the term “imperialism”) of the United States, two influential nations in which the language is spoken. How one tallies the costs and benefits of English as the world’s dominant lingua franca will depend, in part, on how one looks at language: as a tool for international and intercultural communication, as a marker of identity, as an instrument of power, a tool for democracy, a commodity on the professional and cultural market, a human achievement.
It is in this complex context that my remarks take root, and more specifically in the environment of education in France, a country resolute in its protection of the national language. What empowerment is offered by the international adoption of English as a shared language? What risks for national, local and regional languages and for the speakers of those languages? How does the neoliberal reframing of educational objectives toward a market model in higher education influence our teaching (specifically the teaching of language and teaching in the English medium) and thus our students’ learning? What, in addition, are the dangers posed by the global spread of English for native speakers of the language?
I will explore these questions through the prism that is mine: a native speaker of American English, a longtime educator in France at various levels and contexts of instruction and, more recently, the director of the Language Center at the University of Burgundy. My exploration will be experience-based, necessarily narrow-angled and anecdotal but, I hope, enlightening in its way.
Mardi 8 novembre 2022, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Jean-Léo Léonard, université Paul Valéry Montpellier 3
Résumé :
1. Ligne de mire
(en lieu et place »objectif ») : revisiter et infirmer quelques mythes (ou mythèmes), en dialectologie d’oïl
Mythème 1 ( les dialectes seraient statiques, hérités du Moyen âge ou de la période du Moyen français, périodes « formatives »
Mythème 2 ( les dialectes d’oïl n’auraient été que ruraux des sociolectes rustiques Ils auraient été peu pratiqués dans les villes, voire même dans les bourgs Villes et bourgs ne pouvaient être qualifiés de « centres directeurs » town dialects
Mythème 3 continuisme ou la « tapisserie » de Gaston Paris) les dialectes d’oïl se fondent en un continuum de fin dégradé, les dialectes n’existent pas vraiment Faux, ou du moins trop vague et empiriquement non ancré (aucune contextualisation externe derrière cette assertion) Notre étude de cas maraîchine montre le grain fin de l’interactionnisme entre sous dialectes à part entière au sein de diasystèmes (et non de simples points ou pointillés d’un continuum impressionniste)
Objectif de la déconstruction de ces mythèmes contribuer à une dialectologie générale, en synergie avec la linguistique théorique et descriptive, notamment avec la typologie linguistique, mais de manière « non essentialiste»
Ces mythèmes sont des apories ; ils bloquent la réflexion en dialectologie générale
Mardi 15 novembre 2022, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
La langue populaire au début du XXe siècle : les représentations à l’épreuve de l’archive
Agnès Steuckardt, université Paul Valéry Montpellier 3
Résumé :
Les représentations d’une langue du peuple occupent, à partir du milieu du XIXe siècle, une place grandissante dans la littérature, que ce soit dans les romans, d’Eugène Sue à Victor Hugo, ou dans les chansons, d’Aristide Bruant à Jean Richepin. Quand commence la Grande Guerre, les journaux se passionnent pour l’« argot des tranchées », bientôt étudié par les philologues. Dans quelle mesure cette « langue populaire », représentée et décrite, correspond-elle aux pratiques linguistiques réelles des classes populaires ? Si leur parole vive ne nous est pas accessible, les archives collectées pendant le Centenaire de la Grande Guerre permettent aujourd’hui de mieux connaître leur pratique linguistique écrite et de confronter une langue populaire construite par les lettrés avec des usages attestés chez les moins lettrés. C’est à cette confrontation, menée sur la base des archives collectées dans Corpus 14 (https://www.univ-montp3.fr/corpus14/), qu’invite cette conférence.
Mardi 22 novembre 2022, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Analyser les textes philosophiques aujourd’hui
Malika Temmar, université de Picardie Jules Verne
Résumé :
L’analyse du discours est un domaine de recherche bien connu aujourd’hui en France. Après avoir rappelé ses fondements et ses principes, il s’agira ici de se saisir d’un exemple de terrain d’investigation de ce champ, celui de la philosophie. Cette communication cherchera à mettre en valeur la façon dont on peut se saisir des outils d’analyse du discours pour aborder ce type de texte particulier. Les approches énonciatives et pragmatiques seront privilégiées pour analyser les formes expressives de ce genre de discours. Notre présentation mettra en valeur les différents genres et les supports sur lesquels on trouve le discours philosophique, outre les textes sources doctrinaux, il s’agira également d’interroger les nouvelles formes de diffusion de la philosophie dans les médias français.
Mardi 29 novembre 2022, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
La linguistique textuelle française et l’héritage de l’École de Prague au XXI° siècle
Guy Achard Bayle, université de Lorraine
Résumé :
Pour dérouler la chronologie et justifier la continuité épistémologique annoncées ou impliquées par notre titre, notre exposé suivra trois étapes :
Dans un premier temps, nous reviendrons sur les fondements du Cercle linguistique de Prague (CLP), en suivant ses textes fondateurs de 1929 (https://cercledeprague.org/pdf/theses.pdf), et en mettant l’accent sur leur orientation fonctionnaliste (et pas seulement structuraliste) ; cette orientation fonctionnaliste préfigure avec plusieurs décennies d’avance, l’évolution de la linguistique disons classique ou « traditionnelle » vers les « sciences du langage », autrement dit, pour ce qui nous concerne, la « linguistique des textes et des discours ».
Dans un deuxième temps, nous verrons comment la « seconde École de Prague », qui a mis elle l’accent sur la « syntaxe fonctionnelle », a permis dans les années 70 l’éclosion de théories linguistiques aussi diverses, mais complémentaires en termes de cohésion-cohérence macrosyntaxique ou transphrastique, que celles de Halliday & Hasan en Angleterre, ou Combettes et Adam en France ou en Suisse… Entre autres, tant les travaux néo-pragois sur l’actualisation informationnelle de la phrase, ou encore les progressions thématiques, ont eu d’écho, dans toute l’Europe centrale, mais encore en Scandinavie, en Italie, en Espagne…
Dans un troisième temps, nous verrons, sur la base de nos propres travaux, menés pour la plupart en collaboration avec le Pr Ondřej Pešek, franco-romaniste membre du CLP, comment se développe aujourd’hui une linguistique des niveaux « mésotextuels » : le récent ouvrage d’Adam sur le paragraphe en est une des plus fortes illustrations et des plus riches explorations. Avec le Pr Pešek, nous avons également exploré l’organisation informationnelle des paragraphes, mais aussi celle qui se situe, disons, au-dessus, entre paragraphes (https://journals.openedition.org/discours/10799) ; et nous nous tournons aujourd’hui vers l’étude de celle des autres niveaux « méso », comme la période et la séquence.
Mardi 6 décembre 2022, 15h 00 – 17h 00, salle des séminaires MSH
Donner un ordre dans l’espace public
Mustapha Krazem, université de Lorraine
Résumé :
L’injonction consiste à ce qu’un locuteur A pose un acte de langage visant à ce que le destinateur B exécute le procès voulu par le locuteur A.
Révise ton cours de linguistique avant de dîner !
La langue dispose de multiples moyens pour réaliser une injonction. Il est même des moyens non linguistiques de réaliser cet acte (par exemple le panneau « sens interdit ».
On s’intéressera à la façon dont l’injonction est réalisée dans l’espace public en se limitant aux formes linguistiques exemplifiées ci-dessous :
Je garde deux mètres de distance pour protéger les autres
Gardez deux mètres de distance pour protéger les autres
Gardons deux mètres de distance pour protéger les autres
Garder deux mètres de distance pour protéger les autres
. On montrera l’évolution de l’emploi de ces formes depuis une vingtaine d’années, les formes en JE tendant à envahir l’espace public au détriment de l’impératif de deuxième personne. On tentera d’en comprendre les raisons sociologiques tout en montrant que potentiellement toutes les formes ci-dessus étaient prêtes à mettre en valeur des propriétés qui leur sont inhérentes même si elles étaient moins sollicitées auparavant.
Mardi 13 décembre 2022, 15h 00 – 17h 00, salle des séminaires MSH
« Parce qu’euh… j’ai connu un mec qui est un homme averti qu’en vaut deux. Eh ben… » (Coluche)
Samir Bajrić, université de Bourgogne
« L’article prend valeur relativement à un problème qui n’existe pas seulement pour l’esprit d’un peuple, mais universellement pour l’esprit humain, par le fait même du langage. Ce problème date du jour où un esprit d’homme a senti qu’une différence existe entre le nom avant emploi, simple puissance de nommer des choses diverses et diversement concevables, et le nom qui nomme en effet une ou plusieurs de ces choses. Il s’est posé avec plus de force, à mesure que ce sentiment devenait plus net, et il a été résolu […] par l’invention de relations systématiques entre le nom virtuel et le nom réel. Les articles sont, dans la langue, le signe apparent de ces relations ».[1]
La linguistique française (en France et ailleurs) dispose d’un nombre difficilement calculable de travaux portant sur la catégorie grammaticale nommée article. Parmi ces travaux, nombreux sont ceux dont le modèle interprétatif concerne, de près ou de loin, les principes de systématique du langage, courant linguistique fondé par le linguiste français Gustave Guillaume. En publiant son excellent ouvrage Le Problème de l’article et sa solution dans la langue française, en 1919, Guillaume a ouvert une très longue série de recherches extrêmement fécondes en la matière. L’on ne compte plus les travaux dans lesquels Guillaume et les guillaumiens fournissent les bases explicatives à propos des articles français un et le.
Cette conférence mettra l’accent uniquement sur l’article un, communément appelé article indéfini, et qui tire son origine, semble-t-il, de la catégorie du nombre, en français et dans les autres langues concernées.[2] On s’aperçoit que, lors du passage de l’idéogenèse à la morphogenèse, l’esprit du locuteur fonde l’apport notionnel sélectionné (extensité) alternativement dans une valeur d’article ou / et dans une valeur de numéral. Cette discontinuité catégorielle est de nature à créer des ambiguïtés d’interprétation et des saisies médianes ou bi-tensorielles :
- Quand il y a un doute, c’est qu’il n’y a pas de doute (à partir de l’anglais : Whenever there is any doubt, there is no doubt)
- Une fois, on était au restaurant…
- (en temps de paix) : J’ai tué un – Quoi ?! Quel homme ? / Un seul homme ?
- (en temps de paix) : J’ai tué des – Quoi ?! Quels hommes ? / Combien d’hommes ?
- (en temps de guerre) : J’ai tué un homme = « un seul / 1 homme »
- ça marche moins bien avec : Chéri, j’ai un amant…
[1] Guillaume G., Le Problème de l’article et sa solution dans la langue française, Paris, Hachette, 1919, p. 21-22.
[2] À titre de rappel, la partie de langue nommée article n’est pas partie intégrante des universaux du langage. En effet, nombre de langues ignorent cette catégorie.

Mardi 19 septembre 2023, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Séance inaugurale du séminaire (pas de conférence)
Samir Bajrić, université de Bourgogne
Mardi 26 septembre 2023, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Je déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts
Jean-Philippe Pierron, université de Bourgogne
Il est devenu courant que l’expression » je déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts » ouvre nombre de prises de paroles lors de colloques, de conseils scientifiques ou de symposiums. L’apparition d’une telle expression peut être questionnée. Elle exprime a priori le souci de préserver ce que l’on nomme » l’intégrité scientifique. Mais elle le fait au nom d’une conception de l’éthique qui peut être questionnée. L’objet de cette intervention visera à se demander comment de telles formules arrivent dans le champ sémantique d’une société et laquelle. Elle visera ensuite à questionner le fait de savoir si l’on peut vraiment ne pas avoir de conflits d’intérêts ? Et enfin si l’expression d’un conflit d’intérêts est problématique et si oui pourquoi ?
Mardi 3 octobre 2023, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
L’expression du vague en discours juridique et le rôle de l’adjectif
Arthur Joyeux, université de Bourgogne
La mondialisation du droit et la création d’ordres juridiques transnationaux modifient la manière dont les règles et normes juridiques sont formulées, interprétées et appliquées. Deux phénomènes importants relèvent de la « normativité graduelle » (Flückiger, 2007) et de la généralisation du « flou » (Delmas-Marty, 1986) ou du « vague » en droit (Endicott, 2000).
Le standard juridique est l’un des instruments privilégiés de l’expression du vague juridique. Décrit comme une « notion élastique » (personne raisonnable, avantage manifestement excessif, …), délibérément incomplète, non codée par le législateur et dont la signification varie au gré des circonstances, sa face formelle mérite l’attention des linguistes : il donne généralement lieu à des collocations de type N + Adj.
La communication se propose d’interroger le rôle de l’adjectif dans l’expression de la norme vague. Plus généralement : quelle est la contribution de l’adjectif à la formulation de la règle de droit ? Quelle typologie pragmatique de l’adjectif, catégorie intrinsèquement instable (Orlandi, 2020), peut-on dresser à partir de son emploi par le discours juridique ?
Mardi 10 octobre 2023, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Monisme ou dualisme, schisme constitutif de la didactique du chinois
Joël Bellassen, INALCO
La didactique du chinois langue seconde est traversée depuis qu’elle s’est structurée en discipline par une fracture épistémologique, ombre portée de la relation singulière entre langue et écriture en chinois : cette discipline est-elle construite autour d’une unité minimale, le mot, comme dans les langues couramment enseignées, ou bien s’inscrit-elle en rupture en reposant sur deux unités didactiques, le caractère et le mot ? l’approche didactique se doit-elle moniste ou dualiste ? Doit-elle ne conférer à l’écriture chinoise un rôle de simple notation instrumentale de la langue ou bien doit-elle poser d’emblée une dissociation entre un savoir langagier et un savoir graphique, animé par une logique propre et devant faire l’objet d’une transposition didactique spécifique, en partie dissociée de la transmission de la langue ? Le présent article identifie une telle divergence comme un véritable schisme au sein de la didactique internationale du chinois langue seconde.
Mardi 17 octobre 2023, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Monica Paniz, CPTC, GReLiSC
Depuis quelques années, l’évolution des idées arrive à un tournant où des rencontres systématiques entre différentes disciplines se mettent en place afin de révolutionner et renouveler les modèles épistémologiques traditionnels. Les Sciences du Langage et les Sciences Psychologiques sont, dans ce contexte, pionnières de ce besoin d’évolution dans une optique pluridisciplinaire. Les recherches récentes en matière de manifestations linguistiques du syndrome de stress post-traumatique ont permis l’identification et la théorisation du Syndrome psycholinguistique post-traumatique, une véritable nouveauté séméiologique issue des apports de la linguistique à la psychiatrie. Cette nouvelle entité met en avant une caractéristique cardinale du trauma : son indicibilité. Or, les études récentes montrent que le discours de patients bilingues étant affectés par un trouble de stress post-traumatique n’a pas encore été pris en compte par les chercheurs, ni par les praticiens. Le bilinguisme est à l’heure actuelle une condition dans laquelle, pour des raisons différentes et plus ou moins complexes, de nombreux êtres locuteurs se retrouvent. Par conséquent, il est nécessaire que cet aspect soit pris en considération dans le cadre de l’analyse des verbatim[1] et, de manière plus générale, tout au long de la prise en charge clinique du patient. En effet, un locuteur bilingue ou plurilingue entretient des rapports cognitifs différents avec les langues qu’il parle, ce qui pourrait idéalement lui permettre de s’exprimer avec plus de lucidité et de recul dans une langue plutôt que dans une autre, voire de s’exprimer autrement. De plus, le vouloir-dire de la langue, défini comme étant l’ « ensemble d’éléments qui sont d’ordre mental et par lesquels la langue incite le locuteur à choisir tel type d’énonciation (le dire) et d’énoncé (le dit) plutôt que tel autre »[2], est susceptible d’affecter tout un ensemble d’expressions linguistiques qui pourraient ainsi être confondues avec les symptômes cardinaux du Syndrome psycholinguistique post-traumatique. Afin que le système de soins puisse évoluer et s’adapter à un public plus vaste, il est nécessaire que la linguistique (et plus précisément la néoténie linguistique) fournisse d’apports nouveaux à la psychopathologie, notamment en ce qui concerne les rapports cognitifs existants entre locuteurs et langues du monde.
De tous ces constats naît le questionnement fondateur de cette communication : que se passe-t-il lorsque l’individu n’est pas seulement confronté à l’indicibilité du trauma, mais aussi au vouloir-dire de la langue ?
Afin de pouvoir y répondre, nous tâcherons d’analyser d’un point de vue néoténique les récits des patients bilingues blessés psychiques. Dans ce contexte, nous viserons l’identification d’une frontière possible entre les processus linguistiques inhérents à l’indicibilité du traumatisme psychique et ceux respectant le vouloir-dire des langues parlées par les individus concernés. Les résultats de cette recherche seront susceptibles non seulement d’apporter une explication supplémentaire et nouvelle à certains symptômes du Syndrome psycholinguistique post-traumatique, mais aussi de montrer en quelle mesure les acquis théoriques de la néoténie linguistique peuvent être appliqués à des disciplines qui sortent du domaine des Sciences du Langage.
_______________
[1] La dénomination « verbatim » désigne, dans le domaine des sciences psychologiques, l’enregistrement et l’éventuelle transcription à des fins analytiques des propos exprimés par le patient au cours de la séance de thérapie.
[2] Bajrić S., Linguistique, cognition et didactique. Principes et exercices de linguistique didactique, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2009, p. 315.
Mardi 24 octobre 2023, 15h 00 – 17h 00, salle des séminaires R 03 MSH
La théorie de la voix chez Gustave Guillaume : sémantisme du verbe et valeur(s) du pronom on
Manar El Kak, STIH, Sorbonne Université
Le commentaire sportif est presque aussi vieux que la littérature. Mais c’est à partir de la naissance du sport moderne au 19eme siècle, que le commentaire sportif a trouvé une place allant en s’amplifiant dans la presse. D’autre part, ce sous-genre journalistique a saisi, dès leur apparition, les innovations technologiques (photo, radio, internet…). Ma contribution tentera de montrer, à travers l’exemple du cyclisme (et marginalement du foot), comment, historiquement, la préoccupation principale du commentaire a été de tendre vers la concomitance la plus proche possible avec l’événement décrit, notamment par des moyens linguistiques. Cependant, cette quête, poussée à l’extrême, apparaît souvent contradictoire avec la dimension narrative nécessaire au succès populaire des manifestations sportives.
Mardi 7 novembre 2023, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Les indices prosodiques et mimique-gestuels comme marqueurs des opérations énonciatives
Elena Vladimirska, université de Lettonie
Dans la présente communication, nous proposons une étude des unités lexicales françaises – notamment, des marqueurs dits ‘d’approximation’ une sorte de, une espèce de, un genre de, et des indéfinis n’importe qui et n’importe quoi – dans une approche pluridimensionnelle qui s’intéresse à la variation sémantique de ces unités manifestée à travers leur réalisation prosodique et mimique-gestuelle (Vladimirska & Turlā, 2022, Vladimirska, 2023 à par.) Notre étude tire sa source d’inspiration de la notion de geste mental à laquelle Antoine Culioli (2011, 2018) a eu recours pour évoquer l’idée d’une activité interne sensorimotrice à laquelle on n’a pas accès, liée à la mobilisation de représentations mentales, également inaccessibles telles quelles. L’analyse des indices mimiques-gestuels qui relèvent de l’observable contribue ainsi à concevoir l’activité de langage comme une activité corporelle dans laquelle les opérations énonciatives sont marquées non seulement par des formes verbales agencées, mais aussi par les gestes des mains et la direction du regard du locuteur. Nous nous focalisons en particulier sur le rôle des indices prosodiques et mimiques-gestuels dans l’organisation de la scène énonciative (Paillard, 2009, 2011,2017). Dans l’interprétation des données nous nous référons également à la théorie énonciative de l’intonation (Morel&Danon-Boileau, 1998) étendue à la théorie des valeurs énonciatives du regard et des gestes des mains (Morel, 2010, Morel&Vladimirska, 2014). Dans l’intention de travailler sur un langage « non momifié » qui « nous révèle ce qu’est l’activité de langage » (Culioli, 2018 : 74), nous nous sommes appuyés sur les données du corpus oral, constitué à partir de la base de données audiovisuelles © YOUGLISH. Les tracés mélodiques, qui visualisent le mouvement du fondamental (la mélodie), les variations de l’intensité et de la durée, sont obtenus grâce au logiciel de traitement du son Speech Analyzer[1]. Les images sont traitées avec l’utilisation du logiciel d’annotation de fichiers multimédias ELAN[2]. L’analyse du corpus motre, en effet, qu’en dépit des spécificités individuelles qui affectent incontestablement les réalisations prosodiques et gestuelles des unités linguistiques en questions, on peut néanmoins observer une part de l’invariant qui relève, selon nous, des variations sémantique et énonciatives de ces unités.
___________
[1] SIL Language Technology
[2] ELAN (Version 6.2) [Computer software]. (2021). Nijmegen: Max Planck Institute for Psycholinguistics. Retrieved from https://archive.mpi.nl/tla/elan
Jeudi 9 novembre 2023, 10h 00 – 12h 00, salle des séminaires R 03 MSH
La notion de théorie en linguistique : linguistique théorique et théories linguistiques
Philippe Monneret, Sorbonne Université
La diversité des approches contemporaines des phénomènes linguistiques requiert l’élaboration d’une perspective générale en linguistique, qui ne se préoccupe pas seulement de généralisations à partir de descriptions de langues, mais qui prenne également en charge la relation entre les apports de la linguistique générale, descriptive ou typologique et les apports des autres disciplines qui prennent le langage ou les langues comme objets d’étude : philosophie du langage, linguistique informatique, sciences cognitives, etc. C’est cette perspective générale qu’une « linguistique théorique » vise à prendre en charge. Par conséquent, une linguistique théorique conçue de cette façon ne se limite pas à une approche critique des théories linguistiques. Cependant, la question de ce qui est impliqué dans l’usage du concept de « théorie » en sciences du langage fait partie de son programme et elle devra être en mesure d’expliquer notamment pourquoi le terme « théorie » n’a pas le même sens dans l’expression « héorie chomskyenne » que dans l’expression « théorie de l’article » par exemple, ou encore pourquoi on ne rencontre presque jamais l’expression « théorie benvenistienne » seule (mais seulement « théorie benvenistienne de l’écriture », « théorie benvenistienne du performatif », etc.) mais très souvent « théorie guillaumienne », « théorie chomskyenne », « théorie saussurienne », etc. Le propos consistera donc d’une part à tenter de clarifier l’usage de la notion de théorie en linguistique et d’autre part de définir le champ d’une linguistique théorique au sens d’une linguistique généraliste.
Mardi 14 novembre 2023, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Passation de consignes et gestion de classe : l’empan pédagogique des gestes sur les mots
Isabelle Monin, université de Bourgogne, & Damien Deias, université de Lorraine
Les gestes professionnels des enseignants, au sens figuré (Bucheton & Soulé, 2009) comme au sens propre (Duvillard, 2017) constituent des faits communicationnels permettant de conduire les objectifs didactiques et pédagogiques de la classe, faire circuler la parole des élèves, accueillir leurs doutes et difficultés, et canaliser d’éventuels comportements perturbateurs. Lors de cette présentation, nous analyserons les « gestes et micro-gestes de l’enseignant » pour (se) mettre en scène et (s’)observer : la posture gestuée, la voix, le regard, l’usage du mot et le positionnement tactique constituent autant de données à prendre en considération que les phrases prononcées.
En prenant appui sur les théories qui encadrent gestes et micro-gestes professionnels au sein de la situation de communication particulière de la classe, nous en analyserons les pratiques à l’aide de séquences filmées. Nous focaliserons alors notre étude sur la manière dont les enseignants gèrent le maintien de l’attention et conduisent leur classe dans la réalisation d’objectifs pédagogiques. Il s’agira d’observer quels sont les gestes et postures facilitatrices de communication : celles qui favorisent une certaine fluidité, sources d’écoute et de compréhension, et celles qui, au contraire, génèrent incompréhensions, malentendus, ou constituent des freins à l’objectif pédagogique de la séance.
Mardi 28 novembre 2023, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
« – Oui ? fit-il en parvenant à faire sonner cette unique syllabe positive comme un rejet total »
Chantal Rittaud-Hutinet, université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
Les discours en interactions orales non préparées se caractérisent dans de très nombreux moments par la présence d’une dimension personnelle, l’énonciation spontanée étant rarement neutre ou strictement informative et objective, mais infusée de nos appréciations, de notre caractère et de notre subjectivité – goûts et dégoûts, croyances et doutes, humeurs et états d’âme, sentiments et ressentiments, opinions et jugements.
Et ce que nous disons de ce que nous disons, nous désirons souvent le transmettre de façon implicite. C’est alors que nous utilisons des intonations expressives, lesquelles se manifestent au travers de signes vocaux, qui sont des signes linguistiques au même titre que les mots.
D’une grande richesse et d’une grande variété, ces signes sont au cœur de l’acte perlocutoire : ils savent entre autres gauchir le sens dénoté des mots de l’énoncé, le renforcer, le contester, l’infirmer, en réduire la portée, ménager sa face et/ou celle de l’allocutaire.
Comme nous le verrons avec quelques exemples, les orateurs – hommes politiques, avocats – savent depuis toujours les caractériser à leur façon. Mais en ce début du XXIe siècle l’analyse scientifique systématique de la prosodie expressive n’en est qu’à ses débuts.
Après une description des dimensions linguistiques de l’intonation – syntaxique, sémantique – et une (re)définition rapide de la prosodie signifiante, seront examinées les moteurs de l’usage de l’intonation expressive, avec ses avantages et ses inconvénients potentiels.
Puis nous observerons les principaux procédés que découvrent et exploitent les romanciers pour écrire cet aspect de la multimodalité, avant de revenir aux échanges oraux, tout d’abord avec les mots « pauvres », puis avec quelques cas de tactiques interlocutives.
Si le temps imparti le permet, nous aborderons les questions relatives aux fonctions, au fonctionnement, aux significations des signes vocaux, ainsi qu’au processus de la recherche phonopragmatique.
Mardi 5 décembre 2023, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Retour sur un débat à distance entre Guillaume et Benveniste : personne, langue et discours
Olivier Soutet, Sorbonne Université
Centrale au plan anthropologique dans la mise en œuvre du mécanisme énonciatif (plan du langage-phénomène), la personne s’instancie massivement dans la grammaire des langues (plan du langage institutionnel) à travers des formes diverses de systématique, éminemment variables d’un idiome à l’autre : morphologique, morphosémantique et morphosyntaxique. Guillaume aimait à dire que la personne était, saillante ou latente, présente dans toutes les parties de discours, à l’exception, disait-il, de la préposition – mais sans en être sûr, ajoutait-il. D’un autre côté, cependant, la description grammaticale fait droit à des notions comme celles d’impersonnel ou, plus radicale encore, de non-personne (Benveniste). Comment concilier cette double approche ? Faut-il y voir le résultat d’un flou terminologique ou le signe de modalités de présence variables de la personne ? Ces questions seront abordées, sans visée de traitement exhaustif, à partir de faits observables dans le microsystème du verbe français.
Mardi 12 décembre 2023, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
L’intercommunication en crise : la question de la compréhension
Éric Castagne, université de Reims Champagne-Ardenne
Depuis au moins la seconde guerre mondiale, on ne cesse d’entendre que la ou les guerres ont été et sont des opportunités pour accélérer le progrès, l’expansion de la mondialisation et de la démocratie, et que les êtres humains n’ont jamais autant communiqué dans toute l’histoire de l’humanité. D’un côté, nous aurions résolu l’obstacle de la distance interlinguistique babylonienne grâce à l’instauration de la langue anglaise en tant que langue de communication internationale par excellence. D’un autre côté, nous aurions résolu l’obstacle de la distance géographique grâce à diverses techniques de communication (réseaux numériques terrestres, sous-marins et satellites, fibre optiques, 5G, smartphones, Internet, etc. pour les technologies les plus récentes). Grâce à la résolution de ces deux obstacles majeurs, l’intercommunication humaine triompherait sur l’ensemble du globe terrestre et même jusque dans l’espace. Pourtant il est un fait incontestable pour peu qu’on échappe au biais d’exposition auquel on est soumis quotidiennement et pour peu qu’on observe finement la communication interhumaine : « l’incompréhension demeure générale. » (Edgard Morin, 1999). L’objectif principal de ma communication consistera à montrer que, contrairement aux apparences, il n’existe pas dans les faits de stratégie d’intercommunication unique, anglaise ou autre, qui pourrait répondre à l’ensemble des besoins créés par les multiples rencontres et situations internationales, et que, contrairement aux apparences, l’incompréhension linguistique n’a cessé de progresser dans le cadre de la mondialisation en expansion.

Mardi 24 septembre 2024
Séance inaugurale du séminaire (pas de conférence)
Samir Bajrić, université de Bourgogne
Mardi 1er octobre 2024, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Apprendre une langue, construire une vie : le DU Passerelle-Etudiants en exil
Claire Despierres, université de Bourgogne
Résumé :
Le DU passerelle-Etudiants en exil de l’uB accueille chaque année 80 personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays et sont en attente ou bénéficiaires de la protection internationale en France. L’objectif de ce programme est d’accompagner le parcours d’apprentissage linguistique et la reprise d’études universitaires des participants.
Dans une approche holistique, l’équipe développe sa réflexion et la mise en place d’actions prenant en compte les dimensions culturelle (y compris culture éducative), sociale (conditions matérielles de vie et d’apprentissage), psychologiques (polytraumatismes) et affectives (liées à la situation d’exil) des apprenants.
La présentation s’attachera à rendre compte de la complexité de cette situation d’enseignement/apprentissage et de l’indispensable et permanente interrogation sur nos pratiques qu’elle nécessite.
Mardi 8 octobre 2024, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Aliénor Jeandidier, université de Bourgogne
Abstract:
Examining recent popular loanwords from English to French: A corpus-based study to understand the linguistic phenomenon dubbed “buzzwords”. Aliénor JEANDIDIER Scholars from several traditions have explored the ways in which neologisms and borrowings may interfere with language. Buzzwords – which are words used suddenly and frequently at a given time – can fall within the category of neologisms as they are words or phrasesthat may be either totally made up, or used in a way that sounds new and impressive to an uninformed audience. With English being the Internet’s lingua franca, buzzwords can be borrowed words or phrases used such that they seem to pervade the French linguistic landscape. As an example, we may cite “buzz” at the end of the 2000s (Fiévet & Podhorná-Polická 2010). This presentation aims to examine the linguistic phenomenon dubbed “buzzwords”. More specifically, we will be looking at buzzwords of English origin in contemporary French. The main question that arises is: why use English buzzwords? To answer that question, the present study – at the intersection of neology, borrowings, and buzz marketing – reports on a corpus-based analysis that empirically explores the uses of a few loanwords that appear in French Web 2.0 publications during the first two decades of the 21st century. Based on the manual analysis of more than a thousand occurrences taken from CanalBlog and French Web 2017, and on the application of the Behavioral Profile Approach (Gries & Divjak 2009, Glynn & Robinson 2014), we show that a word, and a fortiori a borrowing from English, is not a buzzword per se: it is rather a configuration of uses that makes the buzzword.
Keywords: behavioral profile approach, borrowings, buzzwords, neologisms, uses.
References:
Fiévet,A.-C. & Podhorná-Polická, A. (2010). « Étude contrastive de la circulation des néologismes identitaires pour les jeunes ». Neologica, N°4, Paris: Classiques Garnier, pp. 13-39.
Glynn, D. & Robinson, J. A. (eds.) (2014). Corpus Methods for Semantics. Quantitative studies in polysemy and synonymy. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company. Gries, S. T. & Divjak, D. (2009). «Behavioral profiles: A corpus-based approach to cognitive semantic analysis ». In Evans, V. & Pourcel, S. (eds), New directions in cognitive linguistics, Amsterdam: John Benjamins, pp. 57-75.
Résumé :
Des emprunts populaires récents à l’anglais : étude fondée sur les corpus pour appréhender le phénomène linguistique dénommé « buzzwords ». Aliénor JEANDIDIER Des spécialistes de diverses traditions ont étudié la manière dont les néologismes et les emprunts interfèrent avec la langue. Les buzzwords, caractérisés par une utilisation soudaine et fréquente à un moment donné, peuvent être considérés comme des néologismes: en effet, il peut s’agir de mots ou d’expressions soit totalement inventés, soit employés de façon à ce qu’ils paraissent nouveaux et impressionnent un public non averti. L’anglais étant la lingua franca d’Internet, les buzzwords peuvent être des emprunts utilisés de telle sorte qu’ils semblent envahir le paysage linguistique français. À titre d’exemple, citons l’emprunt à l’anglais buzz à la fin des années 2000 (Fiévet & Podhorná-Polická 2010). Cette présentation propose d’examiner le phénomène linguistique appelé « buzzwords ». Plus spécifiquement, nous étudierons des buzzwords d’origine anglaise en français contemporain. La principale question que nous posons s’intéresse aux raisons qui entourent l’usage de ces mots : pourquoi utiliser des buzzwords d’origine anglaise en français ? Afin d’y répondre, ce travail, situé au carrefour de la néologie, des emprunts et du buzz marketing, rend compte d’une analyse empirique fondée sur l’étude contextualisée des usages de quelques emprunts sélectionnés apparaissant dans des publications françaises du Web 2.0 au cours des deux premières décennies du XXIe siècle. En nous appuyant sur l’examen manuel de plus d’un millier d’occurrences issues des corpus CanalBlog et French Web 2017, ainsi que sur l’application de l’approche du profil comportemental (Gries & Divjak 2009, Glynn & Robinson 2014), l’étude démontre qu’un mot, et a fortiori un emprunt à l’anglais, n’est pas un buzzword en tant que tel : il s’agit plutôt d’une configuration d’usages qui fait le buzzword.
Mots clés : approche du profil comportemental, buzzwords, emprunts, néologismes, usages.
Références bibliographiques:
Fiévet, A.-C. & Podhorná-Polická, A. (2010). « Étude contrastive de la circulation des néologismes identitaires pour les jeunes ». Neologica, N°4, Paris: Classiques Garnier, pp. 13-39.
Glynn, D. & Robinson, J. A. (eds.) (2014). Corpus Methods for Semantics. Quantitative studies in polysemy and synonymy. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company. Gries, S. T. & Divjak, D. (2009). «Behavioral profiles: A corpus-based approach to cognitive semantic analysis ». In Evans, V. & Pourcel, S. (eds), New directions in cognitive linguistics, Amsterdam: John Benjamins, pp. 57-75.
Mardi 15 octobre 2024, 15h 00 – 17h 00, à préciser ultérieurement
Chantal Rittaud-Hutinet
professeure des universités honoraire / chercheur associé clesthia : langage, systèmes, discours (ea 7345)
université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
Résumé :
Quand on veut l’oraliser, l’écrit se révèle souvent ambigu, signe que lorsqu’on parle l’infra-discours, dans ses sous-entendus de toutes sortes – arrière-pensées, second degré, intentions cachées, allusions, double sens – n’est déchiffré que grâce à l’intonation expressive.
Juste retour des choses, un des gros problèmes de la recherche sur l’oralité de l’oral est lié à sa transposition graphique, dès lors qu’elle doit être le miroir fidèle de son contenu en restituant au plus près l’ensemble de ses caractéristiques phoniques.
En effet l’orthographe d’usage, déjà notoirement insuffisante pour restituer la plus grande partie des particularités des sons, est encore moins performante quand il s’agit de la prosodie signifiante : l’écart s’avère encore plus grand avec la réalisation en discours de ses constituants sonores, segmentaux et supra-segmentaux.
D’où ces questions, auxquelles je m’efforcerai de donner quelques éléments de réponse :
– Est-il possible de rendre visible aux lecteurs tout l’implicite de l’énonciation ?
– Comment concrétiser la réalité phonique du sous-texte dans une représentation appropriée et complète ? Peut-on mêler les caractères de la typographie habituelle, avec ceux de l’alphabet phonétique international et d’autres ? Si oui comment, dans quelles proportions ?
– Quelles notations inventer, une fois épuisées les ressources des polices, des styles de caractères, des symboles, des diacritiques, des chiffres, des photos ?
– Le nombre des formes nécessaires pouvant être important, une autre ligne devient vite indispensable sous celle du texte des exemples ; parfois même plusieurs. Combien de lignes supplémentaires sont-elles supportables pour faire apparaître à la fois les indices suprasegmentaux, l’extension syntagmatique des signifiants, des signifiés, les chevauchements de parole, les tons modulés intra-syllabiques ?
– Dans quelle mesure peut-on réussir une ‘bonne’ proportion entre exactitude descriptive, options de transcription et lisibilité, en d’autres termes concilier lecture, reproduction imprimée et rigueur scientifique ?
Mardi 22 octobre 2024, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Relations lexico-sémantiques et leur modélisation à travers les fonctions lexicales
Vladimir Beliakov, université Toulouse 2 Jean-Jaurès
Résumé :
Les lexèmes sont reliés entre eux par des relations paradigmatiques ou d’équivalence / d’opposition et des relations syntagmatiques ou d’enchaînement, un paradigme étant l’ensemble des lexèmes substituables dans le même contexte et le syntagme étant un groupement de lexèmes.
Ces relations si complexes et irrégulières soient-elles peuvent être étudiées et modélisées de façon systématique. Dans notre exposé, nous examinerons les fonctions lexicales, un outil formel développé dans le cadre de la lexicologie explicative et combinatoire et plus généralement dans le cadre de la théorie Sens <=> Texte d’I. Mel’čuk afin de faire face au choix du mot juste et à la production de la combinaison adéquate. Plus précisément, nous montrerons comment la notion de fonction lexicale permet de mettre en évidence les différents types de liens qui unissent des éléments du système lexical de la langue.
Mardi 5 novembre 2024, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
L’article : outil de la définition ou servitude grammaticale ?
Kirill Ilinski, Sorbonne Université
Résumé :
Nous nous intéresserons aux mécanismes discursifs qui régissent le choix entre l’article défini et l’article indéfini. Cela nous amènera à essayer de répondre à quelques questions liées à la catégorie de définition, notamment :
Comment définir la catégorie de définition ?
Quels sont les différents cas de la définition ?
Quels sont les facteurs discursifs qui interviennent dans la définition ?
Quel est précisément le rôle de l’article dans l’expression de la définition ?
Et enfin : pourquoi le choix entre l’article défini et l’article indéfini est l’un des sujets les plus difficiles à enseigner aux apprenants étrangers ?
Mardi 12 novembre 2024, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Recherches contrastives en linguistique romane
Gorana Bikić Carić, université de Zagreb
Résumé :
Dans cette communication, nous nous proposons de présenter le corpus RomCro, conçu à la Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Zagreb, et de montrer ses apports aux recherches contrastives en linguistique romane.
RomCro est un corpus parallèle multilingue et multidirectionnel qui contient des textes littéraires écrits en français, espagnol, italien, portugais, roumain et croate. Toutes les langues sont représentées avec des textes originaux et leurs traductions. Nous développons ce corpus depuis novembre 2019 dans le cadre d’un projet conçu à la Chaire de linguistique romane du Département d’études romanes, Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Zagreb en Croatie. En ce moment, le corpus comprend une trentaine de romans du XXème et du XXIème siècles et environ 16 millions de mots. Il est composé de phrases alignées et il est lemmatisé et annoté morphologiquement, ce qui signifie qu’il peut donner des informations non seulement sur les traductions d’un mot, mais aussi sur l’emploi des catégories grammaticales. Il est accessible sur la plateforme Sketch Engine et, en version non lemmatisée, sur la plateforme ELRC (European Language Resource Coordination) 17, sous licence CC-BY-NC-4.0 (Bikić-Carić / Mikelenić / Bezlaj 2023). Le corpus est prévu exclusivement pour l’utilisation académique et non commerciale. Afin de protéger les droits d’auteur, l’ordre des phrases est aléatoire et il n’est pas possible de récupérer un texte dans sa totalité. Nous voudrions souligner le fait que c’est le seul corpus où sont présentés cinq langues romanes et le croate, ce qui le rend incontournable pour des recherches dans le domaine de linguistique contrastive romane en partant d’une langue slave, le croate, mais il peut être très utile aussi pour les romanistes en général, de même que pour les traducteurs ou les professionnels de l’enseignement.
Nous avons utilisé le corpus RomCro, depuis sa création, dans plusieurs recherches sur la détermination du nom (Bikić-Carić / Bezlaj 2020, Bikić-Carić 2020, Bikić-Carić 2022, Bikić-Carić / Bezlaj 2023, Mikelenić / Bikić-Carić 2023, Bikić-Carić / Căpăţînă 2024) et sur l’emploi de l’infinitif (Bezlaj / Bikić-Carić 2021). Comme nous allons le montrer, nous trouvons la comparaison des phrases alignées très utile dans le but de mieux comprendre non seulement les différences et similarités entre les langues, mais aussi le fonctionnement de chacune d’entre elles.
Jeudi 19 novembre 2024, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Quand ne pas dire, c’est faire
Chems Eddine Chiheb, université de Bourgogne
Résumé :
Notre communication lors de ce séminaire linguistique visera à parler du silence dans la langue pour tenter de le comprendre. Nous nous proposons d’aborder les différentes occurrences du silence qui veut dire quelque chose et qui fait particulièrement un effet dans le discours. En effet, le plus souvent, on traite qu’un aspect du silence, celui d’espace permettant l’acte de langage, tel le vide permettant l’expression de la matière dans l’univers physique. Le silence est parfois employé comme une méthode très parlante selon le moment que l’on choisit de l’insérer dans le discours. Au début, au milieu ou à la fin, le silence n’en demeure pas moins porteur d’une intention d’agir sanctionnée par (l’acte perlocutoire) quand il est suscité intentionnellement par le locuteur. Ici, l’idée est de montrer l’opérativité (en puissance) du silence et l’effectivité de ce dernier dans le discours. L’objectif est non seulement de récuser l’exclusivité d’une définition le réduisant à une immobilité du comportement linguistique, mais également de proposer une nouvelle perspective concernant sa conception notionnelle, celle du lien existant avec le vouloir-dire de la langue.
Mardi 26 novembre 2024, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Genres de discours mode d’emploi
Mustapha Krazem, université de Lorraine
Résumé :
Depuis une vingtaine d’années, la linguistique « interne » s’intéresse aux genres de discours, constructions linguistiques autrefois réservées aux études littéraires jusqu’à ce que Bakhtine introduise une opposition entre genres premiers (les genres quotidiens) et genres seconds (genres élaborés). Après une description théorique et empirique de ces genres, je montrerai quelques exploitations possibles pouvant bénéficier à l’étude des faits de langue.
Mardi 3 décembre 2024, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
Traduction de phraséologismes dans les discours politiques
Yanjing Bi, Capital University of Economics and Business
Résumé :
Les phraséologismes chinois sont des unités linguistiques au-delà du mot ayant des contraintes lexicales, morphosyntaxiques, sémantiques et conventionnelles. Utilisés par la communauté chinoise depuis longtemps, ils sont structurés et stéréotypés, entre autres, les chéngyŭ成语, les guànyòngyǔ惯用语 et les yànyǔ谚语. Ils sont la cristallisation de la sagesse et la créativité du people chinois et reflètent la pensée, la mentalité ainsi que valeurs culturelles de ce dernier. Il s’agit également du système de signes et de symboles le plus économique et le plus efficace de la langue chinoise tout en ayant le plus grand contenu d’information. Ils sont omniprésents dans les discours oraux et les textes écrits, ils sont fréquemment employés dans les documents politiques. En raison des différences politiques, culturelles et linguistiques, ces formules comportent des ambiguïtés et engendreront des difficultés de compréhension aux locuteurs non confirmés. La traduction des phraséologismes constituera ainsi une grande difficulté et une tâche majeure pour les traducteurs. Nous avons pour objectif d’analyser la traduction des phraséologismes du chinois vers le français, en nous fondant sur des cas concrets et authentiques de traduction dans notre corpus constitué d’une centaine de phraséologismes chinois et de leur traduction en français extrait du rapport du 20e Congrès national du PCC. Notre contribution tente de répondre aux questions suivantes : pourquoi utilise-t-on des phraséologismes dans les discours politiques ? Quelles sont les difficultés à les traduire ? Quelles stratégies de traduction devraient être adoptées dans leur traduction ?
Mots-clés : traduction, phraséologismes, discours politique, chinois, français.
Mardi 10 décembre 2024, 15h 00 – 17h 00, salle des séminaires R 03 MSH
Figement et défigements viraux d’énoncés à matrice syntagmatique
Antoine Gautier, Sorbonne Université
Résumé :
Cette intervention s’intéresse à des objets linguistiques particuliers, qui sont longtemps restés dans un angle aveugle de la discipline du fait du partage instauré entre les objets de la syntaxe et ceux de la morphologie. Le développement de la phraséologie depuis quelques décennies permet aujourd’hui de couvrir ces territoires.
Les objets étudiés ici sont des structures formées selon les règles de la syntaxe, mais présentant des caractéristiques de figement total ou partiel qui convie à les considérer au moins pour partie comme des items lexicaux. La notion de figement ou de lexicalisation convoquée par les lexicologues permet de rendre compte le processus dont résulte cet état, et ces faits eux-mêmes peuvent être désignés par exemple par les termes de lexie complexe (i.a. Mel’čuk, Polguère), de synthème (Martinet), de mot aggloméré (Abeillé et Godard). À leur tour, l’analyse du discours et divers courants phraséologiques ont produits des termes comme formule, phrasème, etc., pour désigner de tels objets.
Mais nombre de ces unités lexicales obtenues par figement peuvent subir ensuite un défigement, qui altère partiellement leur forme par la substitution d’un ou plusieurs mots ou morphèmes. Ce procédé de défigement aboutit à deux situations:
soit la source de la construction défigée est identifiée sur le mode de l’allusion, ce qui permet des jeux intertextuels variés sur le mode du détournement: Sur Youtube, personne ne vous entendra crier. (Twitter/X, référence au film Alien)
soit la source de la construction défigée n’est pas/plus identifiable, mais la structure défigée comporte malgré tout une partie de signifié non compositionnelle. Cette partie du signifié est de nature connotative, parfois difficile à expliciter, mais elle est stabilisée par l’usage dans un processus qui relève de l’entrenchment: De quoi Oudéa-Castera est-elle le nom ?
Comme l’indique cette notion, ce travail s’inscrit dans une approche fondée sur l’usage, et plus précisément dans le cadre théorique des grammaires de constructions (Fillmore et Kay, Goldberg entre autres).
Mardi 17 décembre 2024, 15h 00 – 17h 00, amphithéâtre MSH
« Aujourd’hui, maman est morte » ; « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ; […]
ou
La syntaxe dite événementielle : construction et identification
Samir Bajrić, université de Bourgogne
Résumé :
Existe-t-il une syntaxe événementielle ou, plus généralement, une manière de parler et d’écrire qui permette aux usagers des langues naturelles d’effectuer des choix (lexique, syntaxe, intonation, etc.) susceptibles d’être perçus comme étant particuliers, saillants et, mutatis mutandis, représentatifs de ce qu’il est communément appelé événement (événement = « ce qui arrive et qui a de l’importance pour l’être humain », Le Petit Robert) ? Et au-delà de ce strict domaine disciplinaire, la notion même d’événement est-elle identifiable et consensuelle ? Comment trancher entre ce qui est un événement – qui a de l’importance pour l’être humain – et ce qui ne l’est pas – qui n’a pas d’importance pour l’être humain ?
En philosophie, l’événement est un concept qui désigne un fait, situé dans le temps, sortant de l’ordinaire du déroulement du temps. En effet, Karl Jaspers soutient que pour être historique, il faut que « l’événement soit un phénomène particulier, unique, irremplaçable, non réitéré » (Jaspers, 1953 : 44). De quoi rappeler l’approche stoïcienne qui en fait l’objet de « sa logique » (le sens comme logique et événement ; voir Warkocki 2013).
En linguistique, certains estiment que « l’événement, ses protagonistes et les données spatio-temporelles peuvent être exprimés par un énoncé » (Kačić, 1988 : 257). Admettons donc qu’Albert Camus ait opté, dans le célèbre roman L’Étranger, pour l’ordre des mots que l’on sait : Aujourd’hui, maman est morte (le circonstant aujourd’hui y est en position initiale) et qu’il ait réfuté l’idée d’une construction phrastique différente de celle-ci, en l’occurrence : Maman est morte aujourd’hui (le circonstant aujourd’hui y est en position finale). Les deux phrases génèrent deux perceptions différentes de l’événementiel et, ce faisant, impliquent une hiérarchie d’analyse en termes de probité des interrogations à formuler. Pour celle-ci, on aura : « Quand maman est-elle morte ? » Réponse : « Aujourd’hui ». Pour celle-là, on se demandera : « Que s’est-il passé aujourd’hui ? » Réponse : « Maman est morte ».
Je tâcherai de poursuivre dans la voie entamée en élargissant aussi bien le cadre théorique qu’un certain nombre de faits de langue censés représenter le phénomène à étudier.

21 octobre 2021 (salle des conseils MSH Dijon) : introduction
Vanessa Besand (Université de Bourgogne – CPTC) : Les baisers de Blanche Neige.
Henri Garric (Université de Bourgogne – CPTC) : Baisers absolus et baisers burlesques dans la littérature du XIXe siècle et dans le cinéma muet.
25 novembre 2021 (La Nef, centre ville de Dijon, 1 place du théâtre) :
Florence Fix (Université de Rouen) et Corinne François-Denève (Université de Bourgogne, CPTC) : Le baiser interrompu dans le théâtre français du XIXe siècle
16 décembre 2021 (forum des savoirs, MSH Dijon) : Lisa Sancho (Université de Bourgogne, CPTC) :
Elara Bertho (CNRS LAM) : Histoire de baisers. En 3 palimpsestes littéraires – choix de baisers dans la littérature africaine
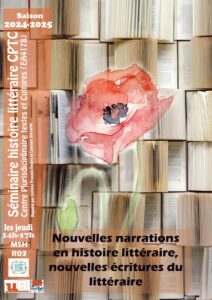
jeudi 23 janvier, 14h-17h, salle R03 de la MSH :
introduction du séminaire par Corinne François-Denève (U. de Bourgogne Europe) : « Vers de nouvelles histoires du théâtre ? »
Laurence Giavarini (U. de Bourgogne Europe) : « Une histoire littéraire « par les familles »? »
jeudi 20 février, 14h-17h, salle R03 de la MSH :
Vanessa Obry (U. de Haute-Alsace) : « Communautés de style »
Florent Coste (U. de Lorraine) : «Division du travail et stratégies économiques dans un atelier de copistes de la fin du XIIe siècle ».
jeudi 20 mars, 14h-17h, salle R03 de la MSH :
Aurore Turbiau (U. de Lausanne) : « Ré-engager l’histoire littéraire : points de vue féministes et lesbiens sur la littérature »
Anne Grand d’Esnon (U. de Lorraine) : « Intuitions diachroniques à l’épreuve de corpus de réception : le cas des variations dans la perception de violences sexuelles fictionnelles »
jeudi 3 avril, 14h-17h (salle en attente) :
Karine Abiven (Sorbonne Université) et Laure Depretto (U. d’Orléans) : « La mobilité sociale est-elle une question d’histoire littéraire ? Le cas des récits de soi »
jeudi 17 avril, 14h-17h, salle R03 de la MSH :
1 – Virginie Brinker, Henri Garric (sous réserve) (U. de Bourgogne Europe), avec des contributrices du numéro : présentation du numéro 3 de SEL « : Sororités »
2 – Bilan collectif et perspectives du séminaire.
